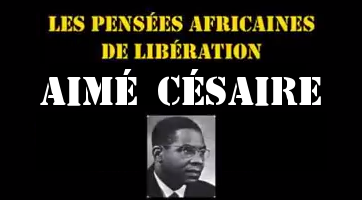Ti Kréol : Bonjour Françoise Vergès. Pour ceux qui ne te connaissent pas,
peux-tu nous expliquer ton parcours ?
Françoise Vergès : C’est toujours difficile de parler de soi, on a tendance à présenter un parcours linéaire, à sélectionner des moments, à éviter de parler des doutes, des erreurs. Alors pour faire bref, mon parcours est le produit de mon éducation qui nous a poussé à voyager, de mes désirs, la conséquence de rencontres inattendues, d’accidents de la vie, de choix. J’ai fait plusieurs métiers et j’ai vécu dans plusieurs pays et partout où j’ai vécu – en Algérie, au Mexique, en France, aux Etats-Unis, en Angleterre – j’ai voulu apprendre le plus possible sur le lieu où je vivais, rencontrer des personnes, observer, être « transformée ».
Je me dis Réunionnaise pour clairement indiquer ce que je dois à ce pays, à sa langue, à son histoire, à sa culture, et aux luttes de son peuple. C’est dans ma vie sur cette île, colonie esclavagiste française puis « département d’outre mer » que j’ai puisé des mémoires, des questionnements, des intérêts, une curiosité jamais éteinte, même s’ils ne concernent pas toujours le lieu « Réunion ».
Ces questionnements, de manière résumée :
1- comment se fabrique le consentement – à l’esclavage, au colonialisme, au capitalisme, à l’impérialisme— comment fait le pouvoir hégémonique pour rendre l’esclavage, le capitalisme, l’impérialisme, aussi naturels que « le jour et la nuit, » que le « il n’y a pas d’alternative » devienne une vérité, qu’on parle de « pragmatisme » pour dire maintien de l’ordre, donc ce qu’il faut de pouvoir d’imagination, de courage, de force de refus pour rejeter cette naturalisation de l’exploitation, de la dépossession, de la racialisation. Les captifs qui se révoltent sur les routes de traite, sur les bateaux négriers, les esclaves dans les plantations, et je parle autant des « petits » gestes de résistance –survivre, inventer, préserver— que des révoltes et insurrections, ou des marrons qui tracent un espace souverain de liberté, de souveraineté, qui réinventent la liberté et une forme de citoyenneté, d’appartenance à une communauté au milieu d’un système qui les pourchassent, les torturent, les tuent, tous déchirent le voile du mensonge de l’injustice comme norme. Ce sont pour moi de formidables figures car elles/ils incarnent au plus profond une rupture avec un ordre établi ;
2- l’intersection entre genre, classe et race, le fait que le contenu donné à droits humains, droits des femmes, qui nous vient de l’Occident n’est pas universel ;
3- la pensée décoloniale toujours croisée avec la classe : comment se défaire de la « colonialité du pouvoir », du vocabulaire, des représentations, des pratiques, des politiques qui s’appuient sur une vision hégémonique du monde – le vocabulaire du rattrapage, du développement, de la croissance, de la nature comme ressource illimitée, le vocabulaire et la pratique des processus de racialisation… ;
4- l’analyse du capitalisme racial et du patriarcat racial ;
5- la représentation, la figuration, l’exposition autrement dit un intérêt pour les formes muséographiques, le cinéma, la littérature, les arts ;
6- l’intérêt pour les circulations sud-sud ;
7- le féminisme décolonial nécessairement antiraciste, anti-impérialiste, et anticapitaliste, questionné par les pensées des peuples autochtones, des queer,
8- et des choses, plus intangibles, comme l’amour de la littérature et du cinéma que m’a donné ma mère, ce qu’est le courage, celui de mes parents, leur engagement pour la justice sociale, contre le colonialisme et l’impérialisme, et celui des femmes et des hommes que j’ai rencontrés. Les amitiés comptent aussi beaucoup pour moi. Mon enfance à La Réunion, c’est l’expérience de la solidarité, de l’internationalisme, de la multiplicité des expressions culturelles et religieuses, de la langue Créole mais aussi du pouvoir de l’État français. Ma rencontre avec « la France », outre à l’école, a été avec son appareil d’État – police, armée, médias et justice coloniale. Je n’ai jamais idéalisé ce pays, il est un parmi d’autres mais j’ai observé comment le pouvoir d’État s’exerce concrètement. Très tôt, encore enfants, nous avons été témoins de la répression étatique qui allait jusqu’à la prison et le meurtre, la censure, le mépris de classe et de race. Les nervis –véritables milices privées armées-, les assassinats impunis d’Éliard Laude, de François Coupou et d’autres, la fraude massive, le mépris, l’arrogance et le racisme des puissants, le harcèlement sexuel contre les femmes des classes populaires, tout cela, qui est maintenant renvoyé au « passé » alors que ça continue, sous d’autres formes, à organiser la dépendance, le conformisme et la peur, a été pour moi formateur.
Pour nous enfants de militants communistes, ce furent les perquisitions au petit matin, les menaces de mort contre mes parents, la racisation des insultes (mon père d’origine « asiatique » était donc « fourbe »), la misogynie contre ma mère, l’anticommunisme violent et l’expérience du conformisme, de la peur comme instrument du pouvoir politique. Ce qui était remarquable, c’était à la fois la solidarité et l’excuse – le « s’il y a répression, c’est qu’il y a une raison » ou « il suffit de ne pas se faire remarquer et ça ira ». J’ai très bien connu ça car le fait que ce soit des enfants – ma sœur, mes frères et moi- qui soient visés par l’État (être suivis, interrogés, empêchés de voyager…) ne gênait pas certaines personnes, et ne les gênent toujours pas. C’est ça aussi la fabrication du consentement à l’injustice, car au-delà de nos personnes, ce que cela enseignait c’était le conformisme à l’ordre postcolonial, à l’Ordonnance Debré, au BUMIDOM, aux rapts d’enfants, à la censure, aux avortements sans consentement, au racisme.
J’ai aussi compris que le binarisme n’explique pas tout c’est-à- dire qu’il n’y a pas que le couple l’État français/La Réunion – même si l’État reste l’acteur dominant, celui qui a le monopole de la violence – mais qu’il faut s’intéresser aux forces locales réactionnaires qui ne sont pas simplement des imitations des formes françaises, elles ont leur propre idéologie et réseaux, elles peuvent être très « anti-France » et totalement réactionnaires.
J’ai eu beaucoup de chance car j’ai été très aimée, ça peut sembler ridicule à dire ça mais comme je me suis sentie toujours sentie encouragée dans mes choix, cela m’a donné une grande liberté.
Quand le FJAR (Front de la jeunesse autonomiste réunionnaise) s’est créé, je l’ai rejoint. Je me posais la question de la place des femmes dans les mouvements révolutionnaires. Mes parents étaient des féministes du Sud, un féminisme anticolonial et anticapitaliste, ma mère a été membre de l’Union des Femmes de La Réunion dès son arrivée sur l’île. J’ai grandi avec une conscience féministe du Sud, j’ai suivi le parcours des femmes algériennes luttant pour l’indépendance et je vois, je constate que le machisme est présent dans les mouvements anticolonialistes.
Ensuite mon parcours est jalonné d’autres expériences : l’Algérie où je passe mon baccalauréat, j’y vais après avoir quitté La Réunion pour connaître un pays qui s’est libéré du colonialisme et l’Algérie avait occupé une telle place dans la vie politique des Sud et dans celle de ma famille ! Je découvre les contradictions d’un État postcolonial, mais c’est aussi une expérience extraordinaire – des amies pour la vie, la découverte d’un pays d’une grande beauté, de cultures diverses, je développe ma cinégraphie, j’apprends un peu l’arabe. Puis je vais en France où je milite dans les mouvements antiracistes, anti-impérialistes, anticapitalistes, avec les Réunionnaises et Réunionnais de l’UGTRF luttant contre le néo-colonialisme et l’Ordonnance Debré. Ma participation au Mouvement de Libération des Femmes compte dans mon parcours comme les débats intenses autour de la psychanalyse, du marxisme. Dans la deuxième moitié des années 1970, je deviens journaliste et éditrice dans l’hebdomadaire des femmes en mouvements et à la maison d’éditions des femmes. Pour la maison d’éditions, je collecte des témoignages de femmes en lutte – par exemple, contre la dictature militaire de Pinochet au Chili ou le totalitarisme en Union soviétique. Ce sont des expériences inoubliables. Mais le MLF se déchire, le groupe « Psy et Po » dans lequel je suis s’approprie illégalement le sigle « MLF » et cela provoque controverses et déchirements. Je quitte la France en 1983. Je pars aux USA en Californie, où je travaille à de petits boulots. Dès 1985, le discours anti-migrants se durcit aux USA, la frontière USA/Mexique devient le lieu où il se joue déjà le plus durement. Au consulat US à Tijuana, je suis témoin des pratiques racistes des officiers. Femmes et hommes du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, qui fuient les guerres fomentées et soutenues par l’impérialisme US, attendent des heures sous le soleil, se font refouler. Je dois subir avec des femmes de tout âge des examens médicaux tout à fait humiliants. Je vis dans une petite ville, Rosarito, au dessous de Tijuana, au bord de l’océan. Le Mexique connaît alors une terrible inflation, on se promène avec des liasses énormes de billets pour acheter un kg de tomates. J’obtiens ma régularisation à l’été 1986 et j’entre avec un visa aux USA le 14 juillet. Je reprends finalement mes études, je m’inscris en Women’s Studies et Political Science à San Diego State University. Je veux obtenir une double licence avec la plus haute distinction – summa cum laude – pour pouvoir postuler dans une grande université pour mon doctorat. Ce sera le programme de doctorat en sciences politiques à l’université de Berkeley. Je publie rapidement en anglais des essais sur les femmes de la Commune
de Paris, Frantz Fanon, l’esclavage colonial, la psychiatrie coloniale et postcoloniale, les femmes en lutte. Je participe à des missions sur les violations des droits des femmes au Salvador alors ravagé par une guerre civile soutenue par les USA, ou au Panama après l’invasion US. Arrêtées et emprisonnées au Salvador, le formidable élan qui nous fait sortir rapidement de prison est impressionnant de générosité et de solidarité. Je participe aux manifestations qui voient le jour à San Francisco autour de la manière dont le SIDA est traité par les autorités médicales et gouvernementales. À Berkeley, j’organise avec d’autres étudiantes un colloque féministe transdisciplinaire de doctorant-e- s, qui rencontre un énorme succès. Il a lieu plusieurs années de suite. J’ai l’immense chance de connaître June Jordan, Barbara Christian, Trinh Thi Min-ha,…, toutes des théoriciennes du féminisme « non-blanc ». Je travaille avec des artistes, je contribue au film d’Isaac Julien « Frantz Fanon, Black Skin, White Mask » (1996). J’obtiens mon doctorat en 1995 et ma thèse est publiée par Duke University Press.
Je reviens en France fin 1995. J’obtiens un poste début 1996 à Sussex University où je reste jusqu’en 2000, puis j’enseigne au Center for Cultural Studies au Goldsmiths College, à Londres (2000-2007). Dès 2000, je contribue aux études préliminaires sur la Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise (MCUR), un projet de musée à La Réunion. En 1998, je m’inscris dans la critique de la commémoration officielle des 150 ans de l’abolition de l’esclavage et participe à la marche du 23 mai 1998. Je commence à publier en français, mon premier ouvrage est Abolir l’esclavage. Une utopie coloniale, les ambiguïtés d’une politique humanitaire. Je suis
tellement choquée par l’ignorance française des siècles où la France a été une puissance esclavagiste et donc de l’inévitable « effet-boomerang », comme l’appelle Aimé Césaire, de l’esclavagisme et du colonialisme, de l’effacement des esclaves Africains et Malgaches comme premiers combattants contre la traite et l’esclavage que je décide d’écrire un ouvrage en français où j’analyse toutes les ambiguïtés de l’abolitionnisme français. Tout en enseignant en Angleterre, je suis active dans le mouvement pour les mémoires de l’esclavage. Je suis nommée au premier comité pour la mémoire de l’esclavage (2002), puis à celui créé en 2004 dont Maryse Condé est la présidente. Le Comité connaît la controverse sur les dates (10 mai ? 23 mai ?), l’offensive contre les lois dites « mémorielles » qui vise en premier la Loi de mai 2001 dite Loi Taubira, le retour du discours sur l’apologie de la colonisation (loi de février 2005). Les castes médiatiques, universitaires, politiques, continuent à voir dans l’esclavage un chapitre parmi tant d’autres, regrettable certes, mais qui ne nous apprendrait rien sur le capitalisme, le racisme, l’organisation internationale du travail, la ligne de couleur…
Puis je travaille à plein temps au projet MCUR, années passionnantes, absolument passionnantes. L’opposition au projet est à la fois réunionnaise et française, violente, très personnalisée donc très sexiste. Le projet est tué en 2010 avec la victoire de la
droite au Conseil régional. Je repars en France, je travaille pour le Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes, je suis présidente du Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (2009-2012), je participe à des rencontres, des manifestations, des débats. En 2014, une Chaire est créée au Collège d’études mondiales, FMSH, Paris à laquelle je donne le nom de « Global South(s) ». Le « sud » n’est pas pris comme une indication géographique mais comme une création économique et politique de la dépendance, de l’exploitation mais aussi comme le lieu d’échanges et de rencontres qui échappent à l’hégémonie occidentale. Je commence dès 2015 à mettre en œuvre une programmation de séminaires, ateliers, et conférences. Je vois cette Chaire – il n’y a pas d’enseignement en vue d’un diplôme au Collège – comme la possibilité d’offrir des plateformes autour de conversations et débats qui, dans l’université, soit n’ont pas lieu, soit doivent répondre aux contraintes du curriculum. C’est donc assez libre. Il y a une plateforme « esclavage » avec le Pr. Marcus Rediker, une plateforme qui a été développée avec le Pr. David Theo Goldberg (religions et espace public en 2015, prolifération du racisme après le « post-racial » en 2016), une plateforme appelée L’Atelier avec des
artistes, une sur postcolonialité et soin…
T.K. : Peux-tu revenir sur l’objectif du MCUR ? Mises à part les attaques personnelles dont tu as fait l’objet au cours de la campagne « anti-MCUR », n’y avait-il pas aussi au mieux une incompréhension ou sinon une opposition à ce que l’on parle du passé et des origines du peuple réunionnais ?
F.V. : Paul Vergès parle dès les années 1960 de ce projet dont l’objectif était de valoriser les différents apports culturels qui ont fait La Réunion, de leur donner part égale, de s’opposer au discours hégémonique qui dit que La Réunion devrait tout à La France.
Quand j’ai commencé à y réfléchir avec Carpanin Marimoutou, nous avons rapidement questionné une périodicité et une spatialité qui collait au récit hégémonique français : prise de possession de l’île par les Français et ensuite, siècle après siècle, ce qui se passe à La Réunion en miroir de la France. Nous avons décidé d’adopter une périodicité et une spatialité qui mettait l’Europe en périphérie, qui dénationalisait et décolonisait l’histoire. Autrement dit, nous sommes une île sur l’axe Afrique-Asie, dans l’Océan indien, espace millénaire de rencontres, de conflits, d’échanges entre Africains, Asiatiques, et habitants du Golfe persique. Partir de cet espace change profondément le regard et la méthodologie. D’une part, les hommes et femmes amenés de force comme esclaves sur cette île, puis les engagés et migrants, sont vus comme venant de sociétés qui ne sont pas sans histoire, qui ne sont pas repliées sur elles-mêmes, il y a des commerçants, des pèlerins, des marchands, des rois et des reines, des marins, des pirates, des artistes, des écrivains, des architectes, des artisans…, bref, des vies sociales et culturelles. L’Europe est lointaine, en périphérie.
La première partie de l’exposition permanente aurait été consacré au monde indiaocéanique jusqu’à l’arrivée des Européens : les villes, les royaumes, le commerce, les littératures, les conceptions du politique, les mythes, les cultures. Puis nous aurions traité de l’esclavage colonial, à La Réunion, dans la région et globalement, un espace aurait été consacré aux colons – qui étaient-ils, d’où venaient-ils, qu’ont ils fait en arrivant ?- aux femmes – blanches et non-blanches- et à part, un espace aurait été entièrement consacré aux marrons, véritables combattants de la liberté. Troisième temps, celui des grandes migrations provoquées par les impérialismes dans l’Océan indien – entre 1830 et 1930, des millions d’Indiens et de Chinois sont jetés dans le circuit international et racialisé du travail, ils fuient famines, dépossession, bouleversements provoqués par les impérialismes, comme sous l’esclavage, ce sont des hommes pour les 2/3 -, le temps des engagés et des migrants de l’Asie du sud et de l’est, de Madagascar et d’Afrique, le temps de leurs cultures, langues, rites, qui s’ajoutent à ceux des esclaves, et déjà le temps d’organisations pour l’égalité, les révoltes des engagés, les premiers syndicats… Un quatrième temps/espace, celui des indépendances qui redistribue les
cartes dans l’Océan indien – les musiques, les symboles, les figures, les grandes idées.. Et pour finir, « La Réunion du temps présent » celle qui se fait chaque jour, une réalisation faite avec les publics à propos des « petits » et « grands problèmes » locaux et globaux, dans une approche intersectionnelle – violence, environnement, genre, LGTBI, exploitation, agriculture, ville/plage/hauts, langues, rites, maison…
Nous voulions privilégier le monde et le temps des migrations dans l’Océan indien. L’espace aurait été celui des « anonymes », des gens « d’en bas » – esclaves, migrants – même si nous aurions évidemment parlé des royaumes et des empires.
Nous nous sommes posés la question de l’objet, de sa fétichisation en Occident. Pourquoi une vie pourrait-elle évoquée exclusivement à partir d’un objet ? Je ne nie pas l’importance de l’archéologie ou de la culture matérielle. Mais dans notre pays, il y a peu d’objets témoins de la vie des esclaves ou des marrons du 17 ème au 19 ème siècle, ni en général des domestiques, des pauvres. Le passé, c’est la grande maison créole des puissants, on ne parle pas des conditions de vie des domestiques dans ces maisons – nénennes, jardiniers, cochers, lavandières, cuisinières… Et nous nous sommes dit : « si nous partions de l’absence des objets ? » Non pas ignorer l’objet mais prendre comme point de départ son absence. Dès lors, que faire et comment faire ? Comment évoquer la matérialité d’une vie ? De la vie d’une jeune femme arrachée à sa terre à 12 ans, jetée comme esclave dans une plantation de Sainte-Suzanne : comment restituer sa présence ? Celle d’un homme venu du Gujerat, du Yémen, de Malaisie, de Madagascar ? Ce furent nos points de départ : autre périodicité, autre spatialité, pas de fétichisation de l’objet. Il y avait aussi d’autres principes : pas d’air conditionné ; le moins possible de lumière électrique ; une architecture ouverte, confortable, accueillante ; pas de séparation Nature/Culture ; des expositions mobiles, en construction avec les publics ; un vrai accueil – pas de ces réceptions froides où les visiteurs se sentent de trop, mais la possibilité de s’asseoir, de poser des questions – ; un jardin où échanger des plantes, échanger des recettes médicinales ; pas de silence imposé mais la possibilité de rire et parler fort ; plein d’endroits où s’asseoir ; une bibliothèque consacrée à la poésie de l’Océan indien, dans plusieurs langues ; la présence de toutes les langues qui ont été parlées et sont parlées à La Réunion, sans traduction systématique, pour provoquer le sentiment d’être étranger, comprendre que tout n’est pas donné, que cette idée que tout doit être immédiatement accessible est une idée liée à la consommation capitaliste ; des ateliers et une galerie dédiée à la vidéo et au cinéma pour encourager l’accès à ces outils par les jeunes. Une galerie dédiée aux Zarboutan Nout Kiltir (ZNK) – un titre que nous avons créé -, ces femmes et ces hommes, qui ont préservé et transmis des savoirs populaires.
En résumé, restituer la singularité de la société réunionnaise et la mettre en relation avec les mondes de l’Océan indien. Nous avons beaucoup travaillé avec des classes et des associations, avec des artistes. Nous avons voulu avoir une équipe de jeunes Réunionnais-es qui ont été formés, à la collecte d’objets, à la recherche, à la communication…, ils ont été une vingtaine. L’équipe suivait de près toute la conception architecturale et technique : comment construire un bâtiment de basse consommation, qui n’exige pas des réparations tous les 5 ans, qui soit une « maison ». Nous avons écrit un programme scientifique et culturel très détaillé, nous avons publié des brochures pour les écoles, collecté ce qui fait une boutik sinwa, interviewé des ZNK, élaboré des programmes de recherche qui auraient été fait avec des chercheurs des pays de l’Océan indien, identifié des collections d’images et de films, conçu l’exposition permanente… L’équipe a énormément travaillé.
L’opposition a été bien organisée. D’abord, en se focalisant sur une personne, la mienne, « Françoise Vergès, la fille de… » pratiquement en un seul mot, à propos de laquelle tout était permis. Je sais bien que tu ne me demandes pas de m’y attarder mais je voudrais malgré tout signaler cette fabrication à travers le nom « Vergès » de l’ennemi, à laquelle il faut ajouter une profonde misogynie. Je pense qu’il faudrait analyser tout ça. Quand on parlait du contenu, ce qui était rare, c’était totalement malhonnête mais à un point ! Quand nous avons parlé de l’absence de sépulture pour les esclaves, un historien réunionnais de l’université a répondu qu’il y avait des cimetières – comme si enterrer quelqu’un était la même chose que lui donner une sépulture ! Quand nous avons dit que les archives étaient celles des puissants, des historiens nous ont attaqués. Il y a eu l’accusation de monter les Noirs contre les Blancs… Les journaux se moquaient de notre collecte des objets du quotidien : « tout ça pour des savates deux doigts ? ».
Il s’agissait de mettre les Réunionnais au centre, de sortir des récits hégémoniques, de partir « d’en bas », de donner au Créole sa place dans le dispositif, et à l’oralité, au rire, au bruit, à la convivialité, mais ça n’a pas eu lieu.
« N’y aurait-il pas une opposition à ce que l’on parle du passé et des origines du peuple réunionnais ? », demandes-tu. J’aurai plusieurs réponses :
- Nous assistons à une réécriture officielle de l’histoire contemporaine – 1945/2000— pour faire accepter le récit d’une modernisation réussie malgré quelques erreurs.
- On peut aussi dire n’importe quoi en toute impunité, mais n’importe quoi. Rien ne se capitalise, rien ne s’établit. Allez dans les écoles et demandez à des jeunes aujourd’hui ce qu’ils/elles connaissent de leur pays. Pas grand chose, ou alors de manière confuse. Allez sur le site du tourisme région, lisez des guides, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer.
- On continue à parler de « Papa Debré » sans se demander quelle est l’origine de cette appellation. L’université relaie cette propagande en parlant des « années Debré » accordant à ce colonial convaincu les transformations de la société. Alors que je dirai que les années 1960 sont des « années réunionnaises » : années de réappropriation de la langue, de l’histoire, de la culture – publication de poèmes, de revues, de brochures, musique marronne du maloya – années de rêve d’un autre futur que celui de l’assimilation, années de solidarité avec les mouvements de décolonisation. Et c’est pour cela que Debré et sa clique répondent en se lançant d’une part dans une modernisation néo-coloniale : ponts, hôpitaux, routes, écoles et d’autre part dans l’assimilation forcée et la destruction des industries locales, la montée inexorable du chômage, l’organisation de l’émigration, l’exil d’enfants de familles pauvres et racisées, la criminalisation de la dissidence. La fin de productions locales en échange de l’économie de consommation.
- Le discours de la pacification est aussi très fort. Là, où la société réunionnaise avait voulu rendre visible les circulations entre religions, communautés, cultures, rites, le pouvoir lui a opposé la « société métisse », masquant les inégalités fondées sur la racisation et faisant du métissage une arme de pacification.
- Parler du passé, oui si c’est pour en faire un argument touristique – faut bien vendre quelque chose – mais pas pour en retirer des outils d’analyse critique sur la colonialité du pouvoir aujourd’hui, sur le devoir de solidarité avec les Comoriens, les Malgaches, les minorités en Inde, en Chine.
- Il y a pratiquement pas d’enseignement de l’histoire réunionnaise à l’école, on assiste à une fabrication de la « tet vid ». Pas de fierté, une histoire soit doloriste soit lissée, neutralisée. C’est une arme formidable d’aliénation.
Mais le pouvoir ne s’exerçant jamais que par la force, il lui faut convaincre les opprimés d’être des soutiens de leur propre oppression, il faut diviser les subalternes. L’idéologie d’une « Réunion exemplaire » dans la République est un leurre et un piège quand ce discours n’émane pas d’en bas, des personnes les plus opprimées. Réunion « exemplaire » : de la pauvreté ? de l’échec de l’école française ? des inégalités ? des effets d’une nouvelle forme de globalisation ?
Je pense que nous sous-estimons encore ce qui s’est passé pendant les décennies qui ont fait passer l’île de la colonie à la colonialité républicaine. Il y a eu un conflit de « basse intensité », pas une guerre coloniale avec armée coloniale d’un côté et guérilla/armée anticoloniale de l’autre, mais une série de dispositifs mobilisant police, gendarmerie, tribunaux, médias, écoles, université, pour neutraliser les aspirations de la société réunionnaise à l’autonomie ou l’indépendance. Il s’agissait de décourager la population de soutenir – et participer au – projet des autonomistes et des indépendantistes, de la démoraliser, de la terroriser en diabolisant l’adversaire. Les femmes du peuple étaient traitées de pétroleuses sans féminité, les hommes emprisonnés, battus, humiliés. A un moment il y a eu des centaines d’hommes réunionnais en prison. La blancheur était célébrée. Le pouvoir a construit deux camps polarisés, systématiquement opposés. Journaux censurés, classe ouvrière réprimée, appauvrissement général, culture réunionnaise niée et bafouée, diabolisation des adversaires, et pendant ce temps, offre d’une assimilation qui donnait accès à la consommation en échange du silence, de l’acquiescement à la dépendance. Comment n’en resterait-il pas quelque chose ? Dénigrement de soi, honte de soi, mépris de l’histoire réunionnaise, voilà ce qu’il y a eu de 1945 aux années 2000. Ensuite, le pouvoir a pris quelques formules et les a détournées – le « métissage » par exemple passé d’un discours contre la pureté blanche (avec ses défauts certes) à un argument de vente et de pacification.
T.K. : Je vois le « militantisme culturel » réunionnais d’aujourd’hui comme justement une réaction à ce déni de l’identité réunionnaise, à l’assimilation forcée qu’a subi la génération de mes parents. Penses-tu que la lutte pour notre identité, notre langue, notre histoire, peut être liée à la lutte sociale pour la dignité des Réunionnais ?
F.V. : C’est inséparable, cela l’a toujours été. On a oublié les nombreuses publications autour du Créole, de la musique, de l’histoire et de la culture réunionnaise dans les années 1960-1970. Il y a eu un formidable élan culturel à l’époque et dans des journaux comme Témoignages ou dans des groupes indépendantistes, on parlait des
luttes pour la dignité dans le monde, d’Angela Davis, des Vietnamiens, des Mauriciens, des Malgaches. Pourquoi cette mémoire anticoloniale a t’elle disparue ? Pourquoi pense t’on qu’il y aurait eu un vide culturel dans ces années, que les Réunionnais se seraient laissé faire ? Quels sont les intérêts à cet oubli ? Cette assimilation forcée qu’ont subit tes parents, il faut se demander comment elle s’est installée, quels ont été les moyens utilisés, si elle a gagné et pourquoi et comment. Qu’a t’elle offert en contrepartie de l’oubli ? Il faut comprendre comment s’est créé un consentement à l’hégémonie assimilatrice, mais aussi dans quels milieux s’est-elle imposée ? Quelles ont été, et quelles sont, les pratiques dissidentes à cette hégémonie ? Les raisons pour lesquelles des Réunionnais ont adhéré à l’assimilation reste une question centrale, je dis bien « adhéré » pas subi, il y a adhésion dans toute une partie de la société réunionnaise et il faut comprendre pourquoi.
Une politique des identités se doit d’être élaborée en relation avec les luttes sociales, environnementales, féministes, et antiracistes. La demande que les postes de décision soient occupés par des Réunionnais est justifiée, mais en quoi garantit-elle plus de justice sociale ? Que faisons-nous de la critique de Frantz Fanon de la « bourgeoisie nationale », du désir du colonisé d’occuper la place du colon pour jouir de ses privilèges et non pour changer les conditions de vie du plus grand nombre ? Que pensent les jeunes sans travail, qui sont les plus nombreux, dans notre pays ? Quelles sont leurs aspirations ? Nous ne vivons pas sous cloche, nous vivons dans un monde où l’économie est financiarisée, où la précarisation est systématisée, où de nouvelles formes de colonisation et de dépossession sont à l’œuvre. Pour nous, à La Réunion, qui avons été intégrés, par notre histoire, au système du capitalisme racial, que pouvons-nous apporter aux luttes contre ce système destructeur de la vie ? Tous les chiffres montrent à quel point les « outre-mer » ont été soumis depuis des décennies à la désindustrialisation, à la dépendance. Comment allons-nous en sortir ? Comment allons-nous nous émanciper, nous décoloniser dans cette période qui s’annonce particulièrement dure pour les peuples du Sud global ? Il faut repartir à l’écoute des Réunionnaises et des Réunionnais.
T.K. : Dans ton dernier ouvrage « Le ventre des femmes », tu parles de ce scandale des avortements et stérilisations pratiqués à l’insu de femmes réunionnaises dans les années 1960-1970. Entre ce drame, celui de la déportation des « enfants de la Creuse », et de l’exil de millier de Réunionnais dans l’hexagone par le biais du BUMIDOM, les « années Debré » s’apparentent à une politique de dé-réunionnisation de la Réunion. Avec en parallèle l’assimilation forcée, et l’immigration de plus en plus forte de travailleurs zorèy à la Réunion, n’est-ce pas le « génocide par substitution » dont Aimé Césaire parlait pour la artinique ? Doit-on avoir peur de ce phénomène ?
La politique d’installation (settler colonialism) est un phénomène qui fait partie des politiques coloniales. À partir du moment où la république parle d’égalité de tous les citoyens tout en autorisant les politiques discriminatoires, on est dans une colonialité républicaine du pouvoir.
Quand tu parles de l’arrivée massive de travailleurs et fonctionnaires zorey à La Réunion, ça m’évoque le mouvement d’émigration massive des Européens dans la deuxième moitié du 19 ème siècle : plus de 60 millions d’Européens partent vers les États Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du sud… Après avoir pratiqué le génocide des peuples autochtones, ils s’installent et font de ces pays des pays de « l’homme blanc » véhiculant des idées racistes. L’Europe se débarrasse de ses classes dangereuses et les transforme en colons blancs : un gain sur tous les plans ! Bien sûr les deux phénomènes ne sont pas similaires mais ce que je veux dire c’est que tous deux démontrent l’existence d’une conviction : que le monde est là pour servir aux occidentaux de terrain de jeux, pour assouvir leurs désirs, apaiser leurs craintes, leur garantir une position de supériorité. Aujourd’hui, pour des Français, c’est formidable de s’installer dans les « outre-mer » : ils échappent aux difficultés en France, vont dans des pays où le français est imposé, c’est la langue officielle, où ils peuvent débarquer sans jamais faire l’effort d’apprendre la langue, l’histoire, la culture du pays et, être « chez eux» ! Les lois le protègent, l’idéologie républicaine qui nie l’existence du racisme structurel le conforte, la colonialité du pouvoir républicain justifie son sentiment de supériorité ! S’il est travailleur, il subit moins le chômage qu’en France ou par rapport aux locaux, s’il est fonctionnaire, il gagne plus qu’en France pour la même position ! Il peut avoir une nénenne, un jardinier, une piscine, séduire une jeune fille « oiseau exotique », justifier sa position en dénigrant les locaux. Ainsi se renforce chez les Français le sentiment qu’ils n’ont pas à se décoloniser.
Mais je voudrais dire que ce dont je parle dans Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme ne se limite pas à un cas « réunionnais ». Le corps mutilé des milliers de femmes réunionnaises enceintes, charcuté par des médecins hommes et blancs, qui en plus se sont fait des fortunes et ne seront jamais punis, est certes à analyser avec le BUMIDOM et les enfants de la Creuse dans le contexte de choix politiques : d’une part, l’État ne développera pas les « DOM », il le dit clairement dans le plan Monnet et d’autre part, dans le contexte de la destruction des industries locales, de la montée du chômage comme conséquence du choix de non-développement. Mais aussi, dans une politique plus large : celle qui consiste à intervenir globalement sur le ventre des femmes non-blanches, à décider qui a le droit de donner naissance et qui ne l’a pas, dans le contexte d’une idéologie au niveau mondial qui fait du contrôle du taux de naissance dans le Sud global, un élément de la politique impérialiste. Et ces drames ont été la conséquence de choix pris en toute conscience, avec la complicité zélée d’intermédiaires locaux. Sans tous ces intermédiaires, ces politiques n’auraient pas autant réussi. Pourquoi des Réunionnaises et des Réunionnais ont-ils consenti à arracher des enfants à leurs parents, à mentir aux jeunes qui partaient par le BUMIDOM, à envoyer des femmes enceintes être avortées et stérilisées sans leur consentement ? Il est temps de se pencher sur les complicités locales : qu’est ce qui les a provoquées ? L’intérêt financier ? L’adhésion à l’idéologie d’assimilation et son mépris des pratiques populaires ? Le désir de bien se faire voir du maître ? Tout ça ensemble ? Il faut analyser les croisements entre racisme, sexisme et classe sociale, c’est impératif.
Pour relancer les luttes sociales, nous pourrions apprendre des pratiques alternatives qui se développent en Amérique du sud et du nord, en Afrique, en Asie, en Europe, de Black Lives Matter aux luttes des peuples indigènes. Développer la solidarité sur l’île et avec les peuples qui nous entourent. Dénoncer le racisme, celui qui consiste à refuser un poste de direction à un-e Réunionnais-e comme celui qui s’exerce contre les Komors, se demander pourquoi un parti comme le FN dans un pays qui a été victime du racisme structurel, où des femmes et des hommes ont été pourchassés, battus, stigmatisés, assassinés au nom du racisme, obtient tant de voix ! Ne nous cachons pas derrière le taux d’abstention. Il y a toujours eu de l’abstention. Que se passe t’il ? Il faut reprendre la réflexion. N’oublions pas qu’un homme politique réunionnais a demandé le retrait du droit du sol à Mayotte et l’imposition du droit du sang ! Il n’y a pas eu de protestation massive contre cette proposition. La lutte contre le racisme structurel est une lutte sociale, politique et culturelle. Encore une fois, je pense que nous devons aller à l’écoute des Réunionnaises et Réunionnais les plus démunis, les plus discriminés pour élaborer de nouvelles stratégies.
T.K. : La situation sociale à la Réunion est alarmante à l’heure actuelle. Mais par-dessus cette situation, j’ai aussi l’impression que nous vivons une injustice : 1 jeune réunionnais sur 2 est au chômage et pour y remédier, on pousse la jeunesse réunionnaise à partir, alors qu’on fait venir de l’hexagone des personnes qui vont occuper des postes qui auraient pu être obtenus par des réunionnais. On nous conseille de partir se faire de l’expérience ailleurs, mais de retour sur le marché de l’emploi local, les jeunes se retrouvent pour beaucoup dans l’impasse. Le Rapport INED 2012 affirme que « A diplôme égal, un Métropolitain semble avoir un avantage sur le marché du travail et accéder plus facilement qu’un natif à une profession de qualification élevée.»). La situation est la même dans les autres « département d’outre-mer ». Il est difficile de parler de cette situation sans se faire taxer de « xénophobe » ou de « raciste ». Pourtant, j’ai plutôt l’impression de voir dans cette injustice la marque de la discrimination raciste et du « privilège Zorèy ». Peux-tu me donner ton avis là-dessus ?
F.V. : Dès le moment où l’État décide, en 1946, que le développement des « DOM » est impossible et que les deux politiques qui doivent être appliquées sont l’organisation de l’émigration et le contrôle des naissances, un choix est fait : il n’y aura pas de travail pour les Réunionnais, ni pour tous les autres « domiens » (désolée pour l’utilisation de ce terme). Mais dans le même temps, et toujours dans ces années fin 1940-début 1950, l’Etat décide que l’appareil d’État et ses institutions – justice, école, police, armée, université— seront aux mains de fonctionnaires zorey car il décide de ne pas former des Réunionnaises et Réunionnais (pareil ailleurs) pour ces postes. Il y a dans cette décision un élément colonial et raciste. Aujourd’hui encore les postes de décision, de chefs de service, dans les institutions muséales ou autres sont en grande majorité aux mains de zoreys. C’est un symptôme de la colonialité du pouvoir, du fait que la structure du pouvoir – qui l’exerce, au nom de quelle idéologie, pour quels objectifs— reste profondément marquée par le colonial et le masculin. On ne parle jamais du fait que ces postes sont comme naturellement occupés par des hommes.
Aujourd’hui, les « outre-mer » sont devenus un terrain d’implantation pour d’autres Français que des fonctionnaires, entrepreneurs, retraités, artistes… Mais ce qui est important c’est : reconnaissent-ils leurs privilèges et y renoncent-ils ? En général, ils ne réfléchissent pas à la place qu’ils occupent et au rôle qu’ils jouent, même quand ils véhiculent des idées progressistes, ces dernières viennent le plus souvent d’un cadre occidental. Ils ne tiennent compte ni des idées locales, ni des luttes locales, ils importent un cadre idéologique et des pratiques. Aucune surprise, car la France n’est pas du tout décolonisée. Quand je parle de décolonisation de la société française, je pars des remarques d’Aimé Césaire sur « l’effet-boomerang » de l’esclavage et du colonialisme, du fait écrit-il qu’on ne « colonise pas innocemment », et qu’il y aura toujours un retour du colonial dans la société qui colonise. Cette dernière sera contaminée par les idées racistes, par l’idéologie du capitalisme racial, que ce soit sa classe ouvrière, ses mouvements progressistes, ou sa classe universitaire, son monde artistique et culturel. Mouvements sociaux, syndicats, mouvements féministes, et partis politiques deviendront aveugles à la question raciale, à la manière dont la classe est racialisée. Le débat « soit la classe, soit la race » est de fait indigent.
Je m’inscris dans la lignée de Cedric Robinson, d’Angela Davis, des féministes du Sud, des penseurs de la décolonialité, et donc, je ne sépare pas les catégories. En résumé, la société française ne s’est pas décolonisée, les mouvements et partis de gauche ne se sont toujours pas demandé comment renoncer aux privilèges de la suprématie blanche. On le voit avec le vote qu’elle accorde à un parti xénophobe et raciste, avec les discours et politiques de partis de gauche et de droite, avec le projet de déchéance de la nationalité par un gouvernement PS, avec le contrôle au faciès, le refus d’accorder le droit de vote aux étrangers (promesse du PS qui date de 1981 !!), avec les camps de rétention à Mayotte, les assassinats de jeunes Noirs ou de jeunes Arabes par des policiers en toute impunité, avec l’Islamophobie qui fait que des féministes françaises pensent qu’il est plus important de persécuter les femmes musulmanes plutôt que de lutter contre le travail précarisé et à temps partiel qui touche en premier les femmes, et je pourrais continuer longtemps comme ça. On l’a encore vu avec l’immense mouvement en Guyane : les Français savaient à peine où c’était, pratiquement personne ne savait que 80% des terres appartiennent à l’État !, que la Guyane manque de lycées, collèges, écoles primaires, routes, cliniques, hôpitaux en 2017, qu’elle a 700km de frontière avec le Brésil et 500 avec le Surinam, des frontières artificielles créées par le colonialisme, que jusqu’à 70/80% des produits consommés viennent de France… Les outre-mer c’est le théâtre de l’absurde. Mais nous devons reconnaître la force de l’idéologie de l’assimilation ! Et cela, bien que la figure hégémonique du citoyen « blanc, mâle et chrétien » ne tient plus. Le désir de rester dans la république française indique t’il le succès de l’assimilation ou qu’un autre contenu pourrait être donné à terme au mot « république » qui veut dire « la chose commune » ? Comme les Noirs américains ou les Afro-Brésiliens qui se battent pour extirper le racisme du système politique et culturel dans lequel ils vivent. Mais ce n’est pas tout à fait pareil puisque nos pays sont géographiquement loin de la France, inscrits dans des régions du monde auxquelles nous appartenons. Est-ce possible d’inventer une manière d’être citoyens d’un même ensemble politique mais en vivant dans un espace éclaté avec des territoires qui ont des mémoires, des langues, des cultures, et une histoire chaque fois singulières, inscrits dans des régions du monde en pleine mutation ? Évidemment, cela ne signifie pas abandonner l’idée d‘indépendance, mais est-ce possible de l’imaginer sans suivre obligatoirement le chemin de l’Etat-Nation ? Même si c’est envisageable, ce sera long : l’État n’a aucun intérêt à renoncer à ces territoires et il a pas mal réussi à diviser les subalternes, à faire de la dépendance le nœud coulant dont on ne peut pas se passer, qui vous tient et vous étrangle. Il y a tout un travail à faire pour contrer l’idéologie « il n’y a pas d’alternative ».
L’accusation de « xénophobie » ou de « racisme » est tout simplement scandaleuse. C’est se moquer de nous. Tous, mais vraiment tous les indicateurs d’institutions étatiques montrent que des discriminations qui privilégient les Français blancs existent. Je n’ai jamais entendu parler d’une discrimination au logement, à l’emploi, à la promotion, à la santé, à l’éducation qui viserait un blanc dans les « outre-mer ». Par contre, que ce soit chez eux ou en France, les citoyens des DOM rencontrent des discriminations. Cette accusation, c’est encore un moyen de s’accrocher à ses privilèges, d’utiliser le principe d’égalité tant qu’il sert à imposer des inégalités. C’est toujours le refus de voir que le racisme est structurel. « Le blanc » peut dire que « nous devons tous être frères et sœurs » et oublier sa couleur, prétendre que nous sommes « tous frères » car cela lui permet de se protéger de la connaissance. Or, il n’y pas d’égalité dans la République, le nom, l’origine, la religion, le handicap, le genre, sont des causes de discriminations. C’est quand même évident !
Mais je voudrais redire qu’il faut aussi que nous nous posions la question de nos complicités passives ou actives. Relisons Césaire, Fanon, Baldwin, Cabral, Mbembe… Et là je reviens à La Réunion. Pourquoi n’a t’il pas encore eu de mouvement de protestation des étudiants réclamant un enseignement moins tourné vers la France, plus en phase avec les besoins du pays et de la région ? Pourquoi l’enseignement des langues de notre région est-il si faible ? Pourquoi n’y a t’il pas à l’université de département des études africaines et asiatiques, d’études féministes ? Qui est invité dans nos écoles d’art ? À l’université ? Qui parle et pour qui ? Pourquoi refusons-nous de redonner à notre société l’histoire des luttes des années 1950-1980 ? Pourquoi avons-nous renoncé à avoir notre propre agenda aux élections et que nous sommes collés aux débats français ?
Pour lutter contre la suprématie blanche à La Réunion, et dans les « outre-mer », il faut déjà se libérer de nos propres aliénations, avoir un horizon d’émancipation qui englobe lutte antiraciste, anticapitaliste, anti-misogynie, anti-homophobie et anti- impérialiste. Quand je vois que pour relancer le tourisme, on peut inviter la fille Hilton, vraiment quelle vacuité, que l’esclavage est toujours peu enseigné – ça dépend en grande partie de la volonté de l’enseignant -, que les inégalités augmentent entre Réunionnais, que l’école perpétue les inégalités et la dévalorisation de la culture et de la langue réunionnaise, qu’un projet aussi coûteux et délirant que la route du littoral en mer continue à se faire alors que dans le monde entier, on réfléchit aux modes alternatifs de transport… Il existe pourtant des initiatives, un retour à des légumes et des fruits qui avaient pratiquement disparu, des pratiques de culture bio, la valorisation de médecines péi, des associations culturelles tournées vers les enfants des classes populaires, des groupes d’entraide de femmes, la préservation de rites, le désir de connaître le pays des ancêtres, un mépris envers politiciens et politiciennes qui révèle une compréhension de la perte chez eux de l’intérêt général… Nous ne vivons pas sous cloche, sous la protection de « maman France ».
Parvenir à ce que des Réunionnaises/Réunionnais (et dans tous les « outre-mer ») puissent avoir accès à l’emploi de manière préférentielle, c’est justice, mais ça ne réglera pas la question plus large du chômage structurel qui existe depuis des décennies, ni de la dépendance et ce n’est pas en elle-même une mesure anticapitaliste. À La Réunion, qu’allons-nous dire aux Comoriens et aux Malgaches qui travaillent sur l’île : « Retourne dans ton pays ? » La question des zoreys qui ont plus facilement accès à l’emploi à La Réunion est une question liée à la colonialité républicaine qui garantit à ses citoyens blancs des privilèges qui sont nés des siècles de colonialisme (esclavagiste et post-esclavagiste). Je donne toujours cet exemple des privilèges du « blanc » : si les femmes françaises ont obtenu très tardivement la plupart des droits civiques – dont le droit de vote en 1945 -, les femmes blanches avaient le droit de posséder des esclaves, avaient ce droit de propriété sur des êtres humains parce qu’elles étaient blanches; elles ont possédé des plantations, et c’était un privilège qui leur était encore une fois accordé parce qu’elles étaient blanches, blanc étant ici le marqueur social et culturel associé à une origine (l’Europe) et une couleur de peau acquis à travers l’histoire de la colonisation. Donc, elles ont droit de propriété sur des êtres humains – les acheter, les vendre, les tuer – bien qu’elles n’ont pas la plupart des droits de citoyenne. La racialisation est plus forte que le genre.
Comment effectuer la décolonisation de nos mentalités ? C’est la question que se sont toujours posée les opprimé-e- s, qui est présente chez Césaire, Cabral, Fanon, Mandela, Malcom X, les féministes noires, latinas, asiatiques, qui a été là au PCR et chez les indépendantistes réunionnais : comment je m’émancipe des représentations, des cadres idéologiques qui m’étouffent et m’aliènent, comment je me libère de mes propres préjugés de classe, de race, de genre, ou homophobes, comment je n’ai honte ni de qui je suis ni du milieu d’où je viens, comment j’affirme ma solidarité avec les plus faibles, les plus précarisés… Nous devons nous déprendre de notre dépendance, de notre désir à être « reconnus » par « la France » mais dans ce pays, les décennies de politique d’austérité ont conduit à l’accroissement des inégalités, les arguments du FN se sont répandu dans la société et les partis politiques ! Quelle est la nature de notre attachement névrotique à ce pays ? Ne devons-nous pas sortir du syndrome postcolonial ? Quelle a été notre place dans les dernières élections présidentielles ? Aucune. Des phrases creuses, des déclarations
d’affection comme si c’était de ça que nous avions besoin et non de respect. Allons-nous contribuer, avec les racisé-e- s et opprimé-e- s en France à faire que ce pays change de paradigme ou allons-nous continuer à nous contenter de miettes ? Si nous ne nous engageons pas dans une nouvelle politique de décolonisation, ça restera comme c’est avec chaque année, plus de pauvres, plus d’inégalités, plus de corruption, plus de prisons, moins d’emplois, mais aussi des gens qui vivent très bien. Nous vivrons comme dans une réserve.
Mèrsi aou Franswaz ! Nartrouv
Propos recueillis pour tikreol.re