Qui était Furcy et pourquoi est-il un symbole réunionnais ? Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous souvenir de l’histoire de ce réunionnais qui défia le système esclavagiste et colonial français en attaquant son maître en justice. Aucun autre esclave dans le monde n’avait osé le faire. Partageons sa mémoire !
Qui était Furcy ?
Furcy était un esclave réunionnais qui a poursuivi son maître Joseph Lory en justice pour l’avoir maintenu en esclavage alors qu’il aurait dû être libre. La mère de Furcy, Madeleine, avait en effet été affranchie par sa maîtresse Mme Routier en 1789, sans que cette dernière ne lui annonce qu’elle était devenue libre… Madeleine ne découvrit qu’elle était libre seulement à la mort de Mme Routier, en 1808.
Jospeh Lory, qui avait épousé une des filles de Mme Routier, tendit un piège à la mère de Furcy en lui faisant signer un document qui lui faisait croire qu’elle toucherait des indemnités pour ses services entre 1789 et 1808. Au lieu de ça, comme elle ne savait pas lire, elle signa un document qui fit de Furcy la propriété de Lory. Madeleine mourut quelques mois après avoir compris qu’elle avait été piégée.
En 1817, Furcy découvre qu’il devrait être libre, et, avec l’aide de sa soeur, attaque Lory en justice pour gagner légalement sa liberté sur l’île Bourbon. Cette bataille judiciaire va durer jusqu’en 1843 , quand les juges français accorderont la liberté à Furcy.
Pourquoi Furcy est un symbole réunionnais ?
Durant son combat, Furcy est passé par l’île Maurice (appelée « île de France » avant que l’île devienne anglaise en 1814) et même en France (la « métropole »). Or la loi française de l’époque disait que l’esclavage n’était valable que dans les colonies, donc en France Furcy était libre. Idem à l’île Maurice où Furcy réussit à obtenir son affranchissement auprès des autorités anglaises. Mais au lieu de vivre comme « homme libre » loin de son île natale, Furcy a préféré se battre jusqu’au bout pour obtenir justice, et pourvoir revenir vivre sur son île natale aux côtés de sa femme et ses enfants.
Furcy est un symbole réunionnais car trop de réunionnais aujourd’hui sont obligés de vivre loin de chez eux alors qu’ils ne rêvent que d’une chose : vivre et travailler au pays.
L’histoire de Furcy doit résonner en chacun de nous, réunionnais, réunionnaises, comme un appel au combat pour la justice.
Sa mémoire doit donner du courage à tous les réunionnais, toutes les réunionnaises, qui ont fait le choix de rester ou revenir vivre à la Réunion, malgré les difficultés.
Vivre ailleurs est peut-être plus facile… tant pis : nous voulons pouvoir vivre chez nous !
Les détails de l’affaire Furcy
Le texte ci-dessous est un extrait de la traduction d’un très bon article d’une universitaire américaine sur l’affaire Furcy : La question raciale et le « sol libre de France » : l’affaire Furcy (site du CAIRN)
À la fin du mois de décembre 1843, les juges de la Cour royale de Paris entendirent plaider pour et contre la liberté d’un homme du nom de Furcy, que l’on prétendait être l’esclave des héritiers de Joseph Lory, planteur pratiquant la contrebande d’esclaves sur l’île de France et allié par son mariage à une riche famille créole de l’île Bourbon.
Vers 1759, une enfant naquit en Inde, à Chandernagor ou non loin de cette enclave française. Lors des controverses ultérieures, certains affirmèrent que Madeleine était née libre et d’autres en firent la fille d’une esclave. À deux reprises, elle fut vendue à des maîtres portant des noms portugais, avant d’être finalement acquise par une Française, Mlle Dispense. Entre 1771 et 1772, celle-ci, accompagnée de trois serviteurs noirs, dont Madeleine qui avait alors 11 ans, se rendit à Lorient en passant par l’île de France (île Maurice). La loi française requérait que tous les esclaves amenés en France soient enregistrés auprès de l’Amirauté dans le port où ils débarquaient, mais à ce jour nous ne connaissons aucun document de ce genre concernant Madeleine. À Lorient, Mlle Dispense et sa suite vinrent habiter chez Mme Routier (Marie-Anne Ursule Desblotières, épouse de Charles-Gabriel Routier de Granval). Un an plus tard, elle entra au couvent et fit don de Madeleine à Mme Routier, qui était enceinte et allait avoir besoin de quelqu’un pour s’occuper d’elle durant son long voyage de retour vers l’île Bourbon (île de La Réunion). La nonne stipula que Madeleine devait être affranchie à l’issue du voyage. Madeleine accompagna Mme Routier, qui donna naissance en mer à son cinquième enfant, une fille, et arriva à l’île Bourbon en 1774.
En 1776, Madeleine était une jeune femme de 17 ans. Elle vivait sur l’une des plantations les plus vastes et les plus importantes de l’île, à la tête de laquelle se trouvait M. Routier de Granval, un Créole âgé de 45 ans. La maisonnée se composait de Mme Routier et de deux filles encore jeunes. Les Routier possédaient 124 esclaves et vivaient dans une maison de pierre. Leurs terres, très étendues, comptaient 10 000 pieds de café, 50 000 de manioc, 75 000 de blé, 5 000 de riz, 120 000 de maïs, 12 000 de haricots, ainsi que 64 vaches, un mouton, 40 chèvres, 8 porcs et 7 chevaux. En 1787, M. Routier, âgé, était mort et avait laissé à la veuve Routier, alors âgée de 45 ans, la direction du domaine. Elle engagea un intendant pour administrer la plantation ; les esclaves étaient désormais au nombre de 131, probablement par suite de leur reproduction naturelle plutôt que par de nouveaux achats.
Madeleine, qui avait 28 ans en 1787, avait elle-même contribué à l’accroissement du capital humain des Routier en donnant naissance à trois enfants : un fils nommé Maurice, une fille Constance, et son benjamin Furcy, qui fut baptisé le 7 octobre 1786. Aucun témoignage ne subsiste quant à l’identité du père ; les trois enfants furent enregistrés comme enfants « naturels ». D’une façon inhabituelle, Constance devait être affranchie un an seulement après sa naissance. Une évocation plus tardive du physique de Furcy lui donne « le teint mulâtre, mais des traits fort réguliers et des cheveux noirs, semblables en tout à ceux des Européens […] une apparence de couleur qui dénote peut-être qu’il y a eu, de la part de sa mère, alliance avec un homme de race nègre ». Cependant, une telle description s’appliquerait tout aussi bien à l’enfant d’un homme blanc et d’une femme indienne au teint sombre. Adulte, Furcy lui-même déclarait être « né Colon Français », « fils d’une Indienne » et « fils d’un Français de naissance ».
En juillet 1789, avec seize ans de retard, Mme Routier tint la promesse qu’elle avait fait à Mlle Dispense et reçut de l’administration coloniale la permission d’affranchir Madeleine. Les documents officiels décrivent Madeleine comme « une Indienne, âgée de trente ans », qui se voit accorder la liberté, selon une formule traditionnelle, « en reconnaissance des bons services qu’elle lui a rendus ». Afin de s’assurer que Madeleine ne devienne pas un fardeau pour la communauté, Mme Routier s’engagea à lui verser une pension de 600 livres en plus de ses dépenses courantes. Madeleine continua toutefois à vivre sur la plantation et, d’après les témoignages ultérieurs de Constance et de Furcy, ne fut jamais informée de son statut de femme libre ni des revenus qui lui avaient été promis.
En 1794, Marie Charles Eugénie, la fille que Mme Routier avait enfantée durant la traversée de l’océan, épousa Joseph Marie Lory, second fils d’un avocat nantais qui s’était installé dans une autre colonie française située à proximité, l’île de France. Le jeune couple s’établit dans la capitale de l’île, Saint-Denis, où Lory est décrit lors d’un recensement comme « négotiant ». Durant la Révolution, les colons de l’île de France comme ceux de l’île Bourbon répudièrent les délégués métropolitains qui leur apportaient la déclaration d’émancipation du 16 pluviôse de l’an II : l’esclavage survécut intact à la Révolution.
Sur la façon dont Furcy devint la propriété de Lory, les récits sont contradictoires. Mme Routier mourut en 1808, l’année où les États-Unis et la Grande-Bretagne interdirent le commerce des esclaves. Le jeune Furcy avait alors 19 ans. D’après des documents et des articles de journaux ultérieurs, il revint à Lory en 1812, en paiement d’une dette (il lui « échut en partage »). Mais ce n’est pas ainsi que Furcy et sa sœur Constance racontaient l’histoire. Selon eux, ce n’est qu’à la mort de Mme Routier que Madeleine apprit qu’elle avait été affranchie en 1789. (Peut-être ces documents secrets furent-ils découverts lors de la lecture du testament de Mme Routier. Le recensement de 1817 indique que Lory est propriétaire de « la succession de Mde Ve Routier ».) Quoi qu’il en soit, c’est également en 1808 que Madeleine apprit qu’elle avait droit à 150 ou à 600 livres par an (sur ce point, les récits divergent de nouveau) depuis l’époque de son affranchissement, c’est-à-dire depuis dix-neuf ans – soit une somme fort élevée au total ! Lory proposa alors à Madeleine un marché : il libérerait Furcy (dans « six mois ou un an », ou bien « deux ans » au plus tard) si elle acceptait de signer un reçu pour les gages que lui devaient les Routier. En d’autres termes, Madeleine comprit qu’elle allait acheter la liberté de son fils au moyen des arriérés de sa pension. Elle se rendit auprès du notaire de Lory (qui était également le beau-frère de celui-ci) et, leurrée, signa un reçu correspondant à une année de pension, tandis qu’elle renonçait au reste de ses arriérés. Le document qu’elle signa ne comportait nulle part la clause relative à l’affranchissement de son fils ; bien au contraire, il faisait de Furcy l’esclave de Lory jusqu’à la mort de son maître. Épouvantée et désespérée de voir Lory revendiquer la propriété de son fils, Madeleine mourut, de douleur dit-on, huit mois plus tard.
Durant les guerres napoléoniennes, l’île Bourbon et l’île natale de Lory, l’île de France, fut occupée par les Britanniques à partir de 1810 ; en 1814, la paix revenue, cette dernière passa sous leur gouvernement. Au cours de la même période, Lory est réputé avoir été l’un des principaux introducteurs du sucre sur l’île Bourbon, aux côtés du puissant comte de Richemont, Philippe Panon Desbassayns, qui fut nommé administrateur des colonies de l’Inde, commissaire général de la Marine et ordonnateur à Bourbon, puis inspecteur général des établissements français de l’Inde en 1814. Bien que la France ait officiellement reconnu en 1815 l’interdiction britannique du commerce des esclaves, durant plus d’une décennie les autorités métropolitaines et coloniales firent comme si elles ne voyaient pas le trafic des contrebandiers qui agissaient dans l’océan Indien. En sa qualité de marchand d’esclaves, Lory allait amplement profiter de cette volontaire négligence.
En 1817, Furcy avait 30 ans, l’âge auquel sa mère avait été affranchie devant la loi, mais à son insu. Au mois de juillet de cette année, de nouveaux magistrats arrivèrent de Paris pour s’installer sur l’île Bourbon dans le cadre du remplacement du personnel judiciaire entrepris au moment de la Restauration. Louis Gilbert Boucher, le nouveau procureur général de la Cour royale de l’île Bourbon, était chargé de représenter les intérêts de ceux qui ne pouvaient parler en leur nom propre, en raison de leur âge, d’une incapacité mentale ou de toute autre circonstance.
Le 22 novembre 1817, un conflit dont les causes ne sont pas tout à fait claires éclata entre Furcy et Lory. Un autre serviteur de Lory, Alphonse, lui fit savoir que Furcy avait quitté son poste « sur les motifs qu’il est libre et veut jouir des droits attachés à cette condition ». En conséquence de quoi, Lory déclara Furcy « marron » et ce dernier fut arrêté au domicile d’une femme de couleur libre, Célérine, qui était peut-être sa concubine et la mère de ses enfants.
La motivation de Furcy lorsqu’il défia Lory en 1817 est en partie obscure à cause de la nature des témoignages conservés. Il ne fait pas de doute que l’arrivée de Boucher, remettant en cause le régime juridique colonial, l’ait confirmé dans sa résolution d’affronter ouvertement l’homme qui avait dupé sa mère. De même, le consentement du roi, en 1817, face à l’interdiction britannique du commerce des esclaves a pu renforcer chez Furcy l’impression d’une vulnérabilité du régime colonial local. Mais il paraît probable qu’un événement déclencheur – peut-être une conversation avec le Créole libéral Jacques Sully Brunet (qui avait, disait-on, une ancêtre malgache dans son ascendance maternelle), ou bien une menace particulièrement hautaine de la part de son maître – ait conduit Furcy à s’enfuir loin de Lory une fois pour toutes.
Au moment de son arrestation, sa sœur aînée Constance, que l’on trouve enregistrée comme la « Veuve Jean Baptiste, habitante, demeurant au quartier St. André […] une mère de six enfants, privée de son mari, sans fortune, sans appui », alla trouver le nouveau procureur général, Boucher, et lui demanda d’enquêter sur la réduction en esclavage illégale de son frère.
Le fait que, dans l’un des mémoires, Constance ait été désignée comme la plaignante a pu être dicté par les hésitations de Boucher au sujet de la capacité légale de Furcy d’ester en justice pour revendiquer sa liberté. Durant la délibération des juges, voici ce qu’il déclara, selon le procès-verbal :
il ne connait pas les loix coloniales sur ce point, qu’un esclave étant mort civilement ne peut agir devant les tribunaux, mais il semble qu’il existe une distinction entre l’individu qui se prétend libre d’origine et celui qui fait dépendre sa liberté de circonstances postérieures à l’esclavage : assujettir le premier à l’assistance d’un patron, c’est préjuger la question contre lui.
Sur ce point, François Xavier Aimé Gillot l’Étang, l’avocat général, lui répondit que « l’usage dans la colonie est de nommer un patron à l’esclave qui se prétend libre pour établir les droits qu’il pouvait avoir à la liberté ». Boucher finit par se plier aux pratiques locales et permit que l’on nomme un patron. Le mémoire de Constance est néanmoins demeuré une pièce importante parmi les témoignages pris en compte par la cour.
Les premières déclarations faites à Boucher par Furcy et Constance insistent sur la duplicité avec laquelle les Routier et Lory se sont comportés vis-à-vis de leur mère : sa condition de femme libre, quoique effective dès 1789, ne lui a été signifiée que dix-neuf ans plus tard. En outre, Lory et son notaire ont intimidé Madeleine pour la forcer à signer les documents qui faisaient de Furcy l’esclave de Lory. Ils ne manquent pas de mentionner les arguments fondés sur la race et sur le « sol libre », qui finiront par revêtir une importance prédominante aux yeux des avocats et des juges. Néanmoins, puisque ces documents sont déjà passés entre les mains des avocats – ce ne sont pas les témoignages bruts de Furcy et de Constance, mais des mémoires rédigés –, il semble vraisemblable que l’argument de la race ait été introduit dans l’affaire par Boucher, qui a pu le rencontrer dans ses lectures, puisqu’il était couramment employé à propos des lois coloniales (nous y reviendrons plus loin).
Boucher prit au sérieux la plainte de Constance et l’informa que Furcy avait droit à une défense gratuite. Il lui enjoignit de s’adresser au « substitut procureur du roi » de la « Cour de première instance », Sully Brunet, riche planteur créole de 22 ans dont les idées étaient pourtant nettement libérales. La première requête déposée par Furcy – élaborée par un rédacteur anonyme, mais dans laquelle il faut probablement voir l’œuvre de Sully Brunet assisté de Boucher – exposait d’une manière formelle une série de raisons justifiant la liberté revendiquée par Furcy. C’est la première fois qu’un avocat tenta de le défendre selon des voies légales ; il vaut donc la peine d’examiner soigneusement ces arguments.
Le premier argument mis en avant est que Furcy était libre parce qu’il était né d’une mère libre. La condition de celle-ci reposait sur trois éléments :
- Comme originaire de l’inde.
- En supposant qu’elle ait pu malgré sa naissance devenir l’Esclave de Mademoiselle Dispense à qui elle avait été confiée pour être élevée en Europe, son apparition sur le sol de la liberté (la France) était suffisante pour lui faire recouvrir sa liberté que Furcy prétend au reste que sa mère n’a jamais perdue ni pu perdre.
- […] qu’admettant pour un instant que malgré les raisons ci dessus déduites elle fut toujours demeurée esclave de Mlle Dispense, il est impossible qu’elle soit devenue celle des Sr et Dame Routier non plus que de ses représentans [sic] qui ne pouvaient jamais justifiés d’aucun titre de propriété et d’acquisition de la dite Madelaine.
Ainsi, d’emblée, les avocats de Furcy mirent l’accent sur deux arguments qui allaient perdurer dans les débats juridiques français durant un quart de siècle : l’argument de la race, selon lequel il est injustifiable de réduire en esclavage les Indiens, et le principe du « sol libre » de la France qui veut que tout esclave mettant le pied sur le sol français devienne libre aussitôt. Afin d’appuyer ces deux éléments cardinaux de sa requête, et pour le cas où l’un d’eux apparaîtrait comme insuffisant, Furcy dénonçait également la cession de Madeleine à Mme Routier, qui avait eu lieu à Lorient, et le fait que cette dernière n’avait pas respecté sa promesse d’affranchir la jeune esclave dès son arrivée sur l’île Bourbon.
En dépit du secours de ces deux juristes bienveillants, la requête de Furcy fut rejetée par la cour de première instance. Le procureur du roi était Pierre Hippolyte Michault d’Émery, qui n’était autre que le beau-frère de Lory et le notaire qui avait dupé Madeleine, cinq ans plus tôt, pour la faire renoncer à sa pension et à son fils. L’avocat général de la Cour royale de l’île Bourbon, Gillot l’Étang, qui prit part aux délibérations, était le cousin germain de Lory. Le premier président était Joseph Boulley-Duparc, un créole de Saint-Martin qui avait pris femme dans une riche famille de planteurs créoles de l’île Bourbon. Aucun de ces personnages ne pouvait entendre les arguments en faveur de la liberté de Furcy et la cour de première instance finit par rejeter sa demande, en faisant observer que la famille Routier avait inscrit Madeleine sur ses registres comme esclave pendant seize ans avant de l’affranchir en 1789 et que Furcy, étant né d’une mère esclave, était donc un esclave lui-même.
Cet arrêt donna naissance à « une rumeur de haro » et le gouverneur y répondit en envoyant Furcy en prison, tandis que son patron faisait appel auprès de la Cour coloniale de l’île Bourbon. Pendant ce temps, le procureur du roi, Sully Brunet, et le procureur général, Boucher, furent démis de leurs fonctions ; le second fut exilé loin de la colonie et un nouveau poste de procureur général lui fut assigné en Corse, à Bastia. Une fois ces agitateurs réduits au silence, la Cour royale de Bourbon confirma la décision de la cour inférieure, le 12 février 1818. Furcy devait demeurer l’esclave de Lory.
Le 2 novembre 1818, Furcy sortit de prison, dépouillé de tous ses papiers, et on l’envoya vivre auprès de la belle-sœur de Lory, une veuve habitant l’île de France. Selon un témoignage cité ultérieurement par les avocats de Furcy, « l’esclave révolté eut à expier par les plus rudes travaux son audacieuse prétention à la liberté ». Furcy ne renonça pourtant pas à obtenir justice. Depuis l’île de France, pendant près de vingt ans, il écrivit plusieurs lettres à Boucher, lui demandant son aide pour trouver de nouveaux documents propres à soutenir sa revendication, tandis que le magistrat quittait la Corse et s’installait à Paris, puis à Poitiers. En 1829, Furcy « éleva de nouveau sa voix ; il réclama avec force sa liberté ». Les autorités anglaises finirent par l’affranchir, pour la raison qu’il n’avait pas été enregistré, ni à la douane, ni sur le bateau qui l’avait transporté sur l’île de France.
Les lettres de Furcy à Boucher, transitant par l’intermédiaire d’un réseau d’alliés qui acheminaient ses missives à son ancien allié, font connaître les sentiments et l’opiniâtreté de leur rédacteur durant son exil à l’île de France dans les années 1820 et 1830. Cette correspondance ne laisse aucun doute sur le fait que Furcy avait une famille et des enfants sur l’île Bourbon, et qu’il souffrait d’en être séparé.
À sa libération, Furcy demeura sur l’île de France et devint une célébrité locale en tant que « confiseur ». Son nouveau négoce lui permit d’ « amasser une fortune qui n’ [était] pas sans quelque importance ». Pourtant, selon son avocat, Furcy « n’est plus agité que d’une seule pensée, celle de venir demander justice en France ». Malgré son affranchissement par les autorités britanniques de l’île Maurice, le gouverneur de l’île Bourbon refusa de protéger Furcy de la confiscation qui le menaçait, au bénéfice des Lory, s’il tentait de rentrer chez lui. Peut-être les élites créoles de l’île Bourbon, particulièrement soudées, s’inspirèrent-elles de l’arrêt rendu en 1827 par la cour de l’Amirauté anglaise au sujet de l’esclave Grace : selon cette décision, les esclaves devenus libres à leur arrivée sur le sol métropolitain ne conservaient pas leur liberté s’ils retournaient de leur plein gré dans une colonie où l’esclavage était inscrit dans les lois.
Dans les années 1830, à un moment indéterminé, Furcy s’embarqua sur un navire, emportant avec lui l’original de sa requête, dissimulé dans la semelle de sa chaussure, et « touch [a] enfin le sol français ». Le 12 août 1835, avec le soutien du procureur général André-Marie-Jean-Jacques Dupin, Furcy demanda à ce que son cas soit examiné de nouveau devant la Cour de cassation, en se fondant sur deux éléments : 1) l’argument de la race, d’après lequel les Indiens ne peuvent être réduits en esclavage ; 2) l’argument du « sol libre », faisant valoir que sa mère avait mis le pied sur le sol de France en 1771. Le 6 mai 1840, la Cour de cassation invalida la décision rendue en 1818 par la Cour royale de Bourbon, en alléguant « le principe du droit public français, lequel assurait le bienfait de la liberté à tout esclave dont le pied touchait le sol de la France » et en ramenant « les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt ». L’affaire fut renvoyée devant la Cour royale de Paris, mais il fallut attendre plus de trois ans avant qu’il n’en soit question. Pendant ce temps, le procureur général Dupin s’était arrangé avec la reine et avec le ministre de la Marine pour que Furcy puisse regagner l’île Bourbon aux frais de l’État.
Au mois de décembre 1843, Furcy revint à Paris, où la Cour royale entendit les argumentations développées par l’avocat de Furcy, Édouard Thureau, par l’avocat des Lory, Alphonse Paillet, et par le procureur général, Michel Hébert. À l’issue de l’audience finale, le 23 décembre, après avoir écouté le discours d’Hébert « avec une attention religieuse », les juges de la Cour royale se retirèrent pour délibérer. Une heure plus tard, le président Séguier déclara que Furcy était un homme libre. Furcy avait alors 56 ans. Sa mère, Madeleine, avait débarqué à Lorient presque quatre-vingts ans plus tôt.
Le verdict de la Cour royale – non seulement Furcy était libre, mais sa mère l’avait été au regard de la loi depuis son arrivée à Lorient en 1772 – était une victoire, mais non un triomphe sans mélange. Si la cour condamnait les héritiers de Lory à payer les frais du procès et rejetait leur demande de dommages et intérêts, rien n’indique que Furcy ait reçu la moindre compensation pour les quarante et une premières années de sa vie qu’il avait vécues en esclavage. Il n’y avait pas de réparation.
L’article complet sur le site du CAIRN : http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=ANNA_646_1305
Pour aller plus loin :
- Le livre de Mohammed Aïssaoui, L’affaire de l’esclave Furcy : récit, éd. Gallimard, 2010
- Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Furcy
- Page Facebook Libèr nout Furcy
- Furcy le film d’animation, en cours de réalisation, prévu pour 2018 : page facebook
Nous sommes les héritiers de son combat,
Libèr Furcy dan nout lèspri !
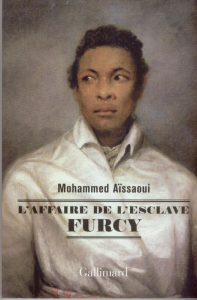
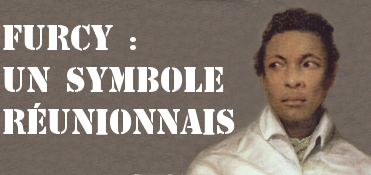




1 Pingback